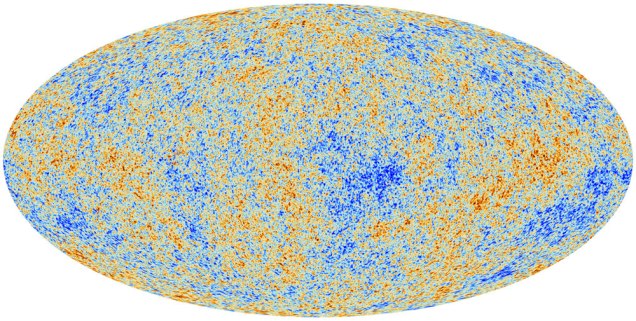Voici une interview publié par La Recherche en 2003.
Stanley Miller : « L'apparition de la vie était inévitable »Il y a juste cinquante ans, l'expérience de la « soupe primitive » faisait la Une des journaux. De l'eau bouillante dans une atmosphère d'ammoniac, d'hydrogène et de méthane ; des décharges électriques simulant les éclairs : à l'aide d'un montage simple, un jeune homme de 23 ans, Stanley Miller, venait de montrer que des molécules essentielles à la vie se forment spontanément dans les conditions supposées de la Terre primitive. Toujours actif, il nous a reçus à Valence, en Espagne, à l'occasion d'un hommage que lui rendait l'université de cette ville
.LA RECHERCHE : Quand avez-vous eu l'idée de vous consacrer à la recherche des origines de la vie ?
Stanley Miller : Je ne me souviens pas d'un moment précis. C'est venu progressivement. La première fois que j'ai entendu parler de ce type de recherches, c'était en 1951. J'étais alors étudiant à l'université de Chicago, qui comptait à l'époque plusieurs professeurs prestigieux, tels qu'Enrico Fermi* ou Harold Urey *, qui avaient reçu des prix Nobel dans les années trente. Comme tout le monde, j'assistais au séminaire qui avait lieu tous les lundis. Un jour, Harold Urey a fait une conférence sur les origines du Système solaire. Selon lui, lors de sa formation, la Terre devait avoir une atmosphère composée principalement d'hydrogène, de méthane, d'ammoniac et d'eau. Il a suggéré qu'un tel mélange devait être assez favorable à la synthèse de molécules organiques, et que cela vaudrait la peine de tenter l'expérience. Cette conférence m'a impressionné, mais je n'ai pas pensé tout de suite que ce serait justement moi qui ferais ça.
Alors, comment avez-vous commencé à travailler avec Urey ?
Stanley Miller : Mon premier projet de recherche était dirigé par Edward Teller*, l'un des concepteurs de la bombe atomique, qui venait d'arriver à Chicago après avoir passé une partie de la guerre au laboratoire militaire de Los Alamos, en Californie. Je me préoccupais de l'origine des éléments chimiques dans l'Univers. Mais, en 1952, Teller est reparti en Californie pour développer le laboratoire militaire de Livermore et la bombe à hydrogène. J'ai dû trouver un autre directeur de recherche pour préparer ma thèse. J'ai alors choisi Harold Urey. Je suis allé le voir et lui ai dit que j'aimerais beaucoup tenter l'expérience qu'il avait proposée dans sa conférence. Il était réticent : il craignait que je n'obtienne pas assez de résultats pour faire une thèse. Comme j'ai insisté, nous avons décidé que j'essaierais pendant six mois. Si je n'obtenais pas de résultat dans cet intervalle de temps, j'abandonnerais et je ferais quelque chose de plus conventionnel. Par exemple, j'analyserais la composition élémentaire de minéraux, ou autre chose du même genre. Mais l'expérience a fonctionné en quelques semaines.Urey n'était pas le premier à proposer ce type de scénario. Une quinzaine d'années auparavant, Alexandre Oparin, un Russe, avait publié un livre sur le sujet.
Pourquoi personne n'avait-il essayé de mettre en pratique les propositions d'Oparin ?
Stanley Miller : À cette époque, la chimie des origines de la vie n'intéressait pas grand monde. Et puis il y avait quand même quelques obstacles techniques. Il ne suffisait pas de synthétiser des molécules organiques en faisant passer des étincelles dans un mélange gazeux. Encore fallait-il savoir précisément ce que l'on synthétisait de cette façon, et en quelles proportions. Et justement le principal intérêt de mes résultats n'était pas que j'aie synthétisé des molécules organiques, mais que j'en aie synthétisé en quantité appréciable seulement quelques-unes. En l'occurrence, il s'agissait de la glycine et des formes a et b de l'alanine qui, justement, sont indispensables à la vie telle que nous la connaissons. Or, les techniques d'analyse qui permettent de le démontrer n'étaient pas très développées. Par exemple, la chromatographie sur papier, que j'ai utilisée pour séparer et identifier ces acides aminés qui s'étaient formés, n'avait été mise au point qu'une dizaine d'années auparavant.
Un certain nombre de géologues pensent aujourd'hui que l'atmosphère de la Terre primitive ne contenait pas de méthane, mais plutôt de l'oxyde ou du dioxyde de carbone. Cela remet-il en question l'intérêt de vos résultats de 1953 ?
Stanley Miller : J'ai refait, et je ne suis pas le seul, le même type d'expériences en modifiant la composition de l'atmosphère. S'il y a vraiment beaucoup d'hydrogène, dans une atmosphère qui contient de l'oxyde ou du dioxyde de carbone, on peut former de la glycine avec un rendement proche de celui obtenu avec du méthane. Mais nos expériences montrent que l'on n'obtient pas d'autres acides aminés. En outre, les rendements chutent très vite dès que la concentration en hydrogène devient égale ou inférieure à celle de l'oxyde ou du dioxyde de carbone. Je demeure convaincu qu'il y avait plutôt du méthane dans l'atmosphère primitive. J'attends que l'on me démontre le contraire.
Espériez-vous fabriquer autre chose que des acides aminés ?
Stanley Miller : Je ne savais pas vraiment ce que j'allais trouver. Les protéines, qui interviennent dans tous les mécanismes de la vie telle que nous la connaissons, sont de longues chaînes d'acides aminés. La première chose à rechercher, c'était si des acides aminés s'étaient formés dans les conditions de l'expérience.Mais les molécules biologiques contiennent d'autres groupements chimiques, d'autres « briques élémentaires ».
Pensiez-vous à ce moment qu'il serait possible de les synthétiser toutes sans utiliser aucun matériau biologique ?
Stanley Miller : Je ne savais pas. En 1953, cela semblait un objectif très éloigné mais possible. Aujourd'hui, je dirais que oui, on peut certainement.
Pourquoi en êtes-vous aussi certain ?
Stanley Miller : Depuis cinquante ans, d'autres équipes ont montré comment fabriquer plusieurs autres molécules ou groupements chimiques dans des conditions abiotiques, c'est-à-dire sans utiliser aucune molécule biologique au départ. Par exemple, on sait synthétiser de cette façon la purine et la pyrimidine, qui entrent dans la composition de l'ADN. En 1961, Juan Oro a synthétisé l'adénine, l'une des « bases » du code génétique, que l'on trouve dans l'ADN et dans l'ARN, à partir de cyanure d'hydrogène. Nous avons ensuite travaillé ensemble et nous avons synthétisé la guanine, une autre base de l'ADN et de l'ARN, toujours sans utiliser de molécules biologiques. Mais je n'ai pas d'idée sur la façon de tout synthétiser.
Quelles sont les principales « briques » que l'on ne sait pas encore produire dans des conditions abiotiques ?
Stanley Miller : Ce serait un peu long de dresser une liste complète. Mais, pour citer des exemples simples, on ne connaît pas de synthèse qui me paraisse satisfaisante pour certains acides aminés que l'on trouve dans nos protéines, tels que l'arginine, la lysine ou l'histidine. Ce qui est au moins aussi problématique, c'est la façon dont ces briques se sont assemblées pour former des macromolécules. Aujourd'hui, les mécanismes de synthèse des protéines dans les cellules reposent sur l'existence préalable d'autres protéines, d'enzymes et de molécules qui portent le code génétique. J'avoue que je n'ai pas d'idée sur la façon dont tout cela a commencé.
En 1953, vous avez fait bouillir de l'eau, et vous avez donc envoyé des étincelles dans un mélange gazeux chaud. Mais, par la suite, vous avez proposé que la vie serait apparue dans un milieu plutôt froid. Pourquoi ?
Stanley Miller : Parce que les constituants élémentaires de l'ADN, en particulier, ne sont pas assez stables à haute température. À 100 °C, le ribose est complètement détruit en quelques heures. Et les « bases », comme la cytosine, l'adénine ou la guanine, disparaissent en quelques jours, au plus en quelques années. Ces durées sont trop brèves pour que les molécules puissent s'accumuler en quantité suffisante avant de commencer des réactions de polymérisation*.
Vous avez aussi écrit que, dans une « soupe primitive » partiellement gelée, il serait plus facile de concentrer les constituants organiques.
Stanley Miller : Oui, quand vous congelez un mélange d'eau et de molécules organiques, la glace qui se forme en premier est plus pure que le liquide. C'est un phéno-mène du même type que ce qui se produit lors d'une distillation : on concentre progressivement les molécules organiques dans le liquide restant. Dans une soupe primitive partiellement gelée, on aurait donc une accumulation et une concentration des molécules organiques : ce sont des conditions favorables pour qu'elles réagissent entre elles.
Depuis quelques années, vous menez aussi des expériences dans des conditions qui évoquent la « petite mare chaude » suggérée par Darwin en 1871. L'origine de la vie ne serait-elle donc pas totalement froide ?
Stanley Miller : Ces expériences reproduiraient plutôt les conditions qui règnent sur une plage ou un fond de mare qui sèche doucement. Nous avons en particulier fabriqué de la cytosine à partir d'urée et de cyanoacetaldéhyde. Mais l'un de nos résultats importants est que cette synthèse est assez efficace à basse température, vers 0 °C. Cela confirme mon idée que la vie est apparue à basse température. En tout cas, elle n'est pas apparue dans l'eau bouillante, près de volcans ou près des fumeurs océaniques, comme certains l'ont proposé. Les organismes qui vivent là, que l'on appelle les hyperthermophiles, sont peut-être les plus anciens ancêtres communs des organismes vivants actuels, comme le prétendent certains biologistes. Mais alors, cela est dû au hasard d'une sélection tardive au cours de l'évolution : les premiers organismes vivants n'étaient pas des hyperthermophiles.
L'an dernier, vous avez publié les résultats d'une expérience qui a duré vingt-sept ans. Qu'avez-vous trouvé ?
Stanley Miller : Pendant toutes ces années, j'ai laissé une solution de cyanure d'ammonium dans un congélateur, à 78 °C. En analysant cette solution, nous avons trouvé que des pyrimidines et des purines s'y étaient formées. C'est une démonstration assez convaincante de l'importance qu'a pu avoir le mécanisme de concentration par congélation dans la formation de molécules biologiques sur la Terre primitive. Même si le cyanure d'hydrogène n'était présent qu'en faibles concentrations dans l'océan primitif, ce mécanisme a pu permettre la formation assez rapide de ces molécules importantes.
Avez-vous d'autres expériences analogues en cours ?
Stanley Miller : Non. Ces vingt-sept ans étaient une sorte de pari, et cela a très bien marché. Mais c'était juste un essai isolé.Vous vous intéressez aussi à l'origine du code génétique. Que pensez-vous de l'hypothèse développée depuis une vingtaine d'années selon laquelle il aurait été porté d'abord par l'ARN seulement ?
Stanley Miller : Cela me semble difficilement conciliable avec ce que nous savons de la chimie abiotique. L'ARN est, comme l'ADN, une molécule trop complexe. Nous ne connaissons pas vraiment de voie de synthèse abiotique pour tous ses constituants. Et certaines réactions nécessaires lors de la polymérisation des chaînes d'ARN sont notoirement difficiles à réaliser dans des conditions abiotiques. En outre, le ribose, par exemple, est très instable. Je ne crois vraiment pas qu'elles se soient formées en l'absence totale de vie. Je pense plutôt que le code génétique a d'abord été porté par des molécules plus simples, telles que les acides nucléiques peptidiques. Ce sont aussi de longues chaînes moléculaires, mais dont le squelette est un simple pep-tide, un polymère d'acide aminé. Ce squelette porte les mêmes bases que l'ARN. Je pense que c'est un bon choix. Ces molécules ont une structure prometteuse pour être les premières macromolécules abiotiques.
Justement, avez-vous trouvé une synthèse abiotique pour ces acides nucléiques peptidiques ?
Stanley Miller : Non, pas encore. Mais nous avons déjà montré comment obtenir les différents éléments. Notamment, le dérivé de la glycine qui forme le squelette par polymérisation a été produit lors d'expériences de décharges électriques. Et nous avons déjà des résultats concernant la polymérisation elle-même.
Ces acides nucléiques peptidiques peuvent-ils remplir les mêmes fonctions que l'ARN ?
Stanley Miller : Ils ont le potentiel pour cela. En particulier, ils se lient facilement aux chaînes d'ADN. Mais nous n'en avons pas encore trouvé qui s'autorépliquent, par exemple, ni qui catalysent la formation de protéines.
D'après vos expériences, il semble que la vie doive nécessairement émerger dès que les conditions chimiques sont réunies. L'apparition de la vie est-elle une simple conséquence de l'évolution chimique ?
Stanley Miller : Oui, c'est ce que je crois. Même si une part de hasard est intervenue dans le processus, l'apparition de la vie était certainement inévitable. Mais je ne suis pas aujourd'hui en mesure de le démontrer formellement.Ce processus a-t-il pu se produire ailleurs, sur d'autres planètes ?
Stanley Miller : Oui, certainement. La vie a pu apparaître n'importe où, à partir du moment où les bons ingrédients étaient réunis, suffisamment longtemps et dans les bonnes conditions. Je suis convaincu qu'il y a de la vie ailleurs dans l'Univers. Je ne sais pas à quoi elle peut ressembler, mais elle existe forcément.
Vous avez commencé la chimie prébiotique quand vous aviez seulement 22 ans. Vous en avez aujourd'hui 73. N'avez-vous jamais pensé changer radicalement de sujet de recherche ?
Stanley Miller : Oh si, j'ai pensé à faire d'autres expériences complètement différentes, mais j'ai dû chaque fois revenir aux origines de la vie. Je n'avais déjà pas assez de temps pour faire tout ce que j'avais envie de faire dans ce domaine.
Pensez-vous qu'aujourd'hui encore la recherche sur les origines de la vie pourrait être le projet d'une vie pour un jeune chercheur ?
Stanley Miller : Je suppose que oui. Il y a toutes sortes de travaux intéressants qui produisent des résultats dans ce domaine aujourd'hui.
Mais reste-t-il à faire des expériences aussi spectaculaires que la vôtre en 1953 ?
Stanley Miller : Sans doute, mais je ne sais pas lesquelles. Si j'avais une idée, je la mettrais en oeuvre. D'ailleurs, si un étudiant brillant venait me voir avec une bonne idée d'expérience, je l'aiderais sans hésitation.
Pensez-vous que nous sommes proches de la compréhension des origines de la vie ?
Stanley Miller : Non, nous en sommes encore éloignés. En revanche, je n'ai aucun doute sur le fait que nous comprendrons un jour. Depuis cinquante ans, nous avons énor-mément progressé, nous disposons de beaucoup plus d'éléments.Propos recueillis par Luc Allemand